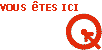|
||||||||||||||||||
| Informations manquantes ? | ||||||||||||||||||
| Envoyez vos textes au webmaster | ||||||||||||||||||
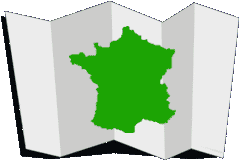 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Histoire | ||
| voir les photos | ||
Notons que le mouvement des camisards dura deux années.
* Les camisards tirent leur nom de la chemise en occitan. Ces partisans pour se reconnaître, la nuit, portaient des chemises blanches.
| Informations manquantes ? |
Envoyez vos textes au webmaster |
||||
| Description Géographique | ||
Le Tarn -il prend sa source dans la commune- va livrer, un peu en aval, ses superbes gorges. Il reçoit dans le village le Rieumalet.
Les hameaux typiques des Ă©carts, Finiels, Villeneuve, Montgros, Champlong, etc... ne manquent pas de charme.
Il faut noter que l'espace des rives droites du Tarn et du Rieumalet échappe à l'entité montvertipontaine et que quelques habitations de ce superbe site échoient au secteur de Fraissinet-de-Lozère.
Les Cévennes, ici, cisèlent dans le vieux socle hercynien des montagnes lozériennes un décor merveilleux.
La ligne de partage des eaux, entre la Garonne et le Rhône, -donc entre l'océan et la mer- s'inscrit sur les hauteurs et entraîne des influences climatiques fort nuancées où, cependant, on serait tenté de dire que le climat méditérranén serait le plus dominant.
La neige surprend, parfois, mais s'attarde plus longtemps à blanchir les cimes qu'à recouvrir la vallée.
* Une faute est commise, de nos jours, par l'immense majorité des personnes qui parle de ce département en disant "la" Lozère. On devrait dire le département de Lozère. Lozère est un massif montagneux et non un cours d'eau.
| Informations manquantes ? |
Envoyez vos textes au webmaster |
||||
| Personnages célčbres | ||
(Source Quid).
Bienheureux Urbain V (pape).
Guillaume de Grimoard, né en 1310 au château de Grisac en Gévaudan, eut pour parrain de baptême Elzéar de Sabran, apparenté à la famille de sa mère, qu'il aura la joie de proclamer saint le 15 avril 1369 à Rome. Étudiant à Montpellier puis à Toulouse, il entra chez les bénédictins de Chirac prés de Mende. Il fit sa profession monastique à l'Abbaye Saint-Victor de Marseille et fut ordonné prêtre en 1334 Il enseigna brillamment le droit canon à l'université de Montpellier, puis il exerça la charge abbatiale à Saint-Germain d'Auxerre en 1352 et à Saint-Victor de Marseille en 1361. Il fut envoyé à plusieurs reprises en Italie comme légat par le pape Innocent VI et il se trouvait à Naples quand il apprit que les cardinaux l'avaient élu pape le 28 septembre 1362. Dès son arrivée à Avignon, il fut intronisé le 31 octobre sous le nom d Urbain V, puis consacré évêque et couronné le 6 novembre dans la chapelle du Palais Vieux, sans aucun faste extérieur.
Il assuma avec le plus grand sérieux ses hautes responsabilités, tout en demeurant un moine fidèle à son habit et aux moindres détails de la règle bénédictine. Il partageait son temps entre la prière, l'étude, le courrier et les audiences, attentif aux affaires de l'Église et aux misères du monde, très généreux envers les pauvres et les malades, se contentant d'employer ceux qui le méritaient sans favoriser sa famille. Il protégea les lettres et les sciences, développant les universités et en fondant de nouvelles. Il restaura l'abbaye de Saint-Victor et les églises romaines. Il s'attacha à l 'expansion de la foi catholique avec les missions franciscaines, au rétablissement de l'unité de l'Église en Orient, à la réforme ecclésiastique et au retour du siège apostolique à Rome.
Malgré les instances du roi de France et les récriminations des cardinaux, pressé aussi par les menaces des Grandes Compagnies, Urbain V quitta Avignon pour Rome le 30 avril 1367. Il y fit son entrée solennelle le 16 octobre, après un long voyage par mer et un séjour mouvementé à Viterbe. Il fut accueilli avec une grande joie et y séjourna trois ans, y couronnant l'empereur d 'Occident Charles IV et y recevant l'acte de réconciliation de l'empereur byzantin Jean V Paléologue. Mais la situation romaine était toujours aussi troublée par la faute des factions rivales et faisait craindre pour la sécurité du pape. Alors, encouragé par la majorité des cardinaux, poussé par le désir de rétablir la paix entre la France et l'Angleterre, et malgré les supplications des fidèles, Urbain V s'embarqua de nouveau pour aborder à Marseille le 16 septembre 1370. Il fut reçu triomphalement à Avignon le 27 du même mois. Cependant, profondément marqué par son échec et atteint par une cruelle maladie, il mourut trois mois après, le 19 décembre 1370, dans la résidence de l'évêque d'Avignon, son frère Anglic. Il fut enterré à la cathédrale Notre-Dame des Doms puis, selon son désir, transféré en 1372 à Saint-Victor de Marseille. A la faveur des nombreux miracles produits sur son tombeau, son procès de canonisation fut ouvert mais bientôt interrompu par la crise du Grand Schisme. C'est seulement le 10 mars 1870 qu'il fut déclaré bienheureux par le pape Pie IX .
Le poète Pétrarque a écrit de lui: "O grand homme, sans pareil dans notre temps et dont les pareils en tous temps sont trop rares".
Source catholique-avignon.cef.fr
L'abbé du Chayla.
L'assassinat de l'Abbé du Chayla, archiprêtre de Mende et inspecteur des missions en Cévennes, constitue le point de départ de l'épisode dramatique des camisards qui, manifestement, traduit l'intolérance religieuse de la Maison de France.
Cet abbé était mandaté par la connivence du roi, Louis XIV, et de l'Eglise pour éradiquer l'existence huguenote dans les Cévennes. Les adeptes de la Réforme, depuis la Révocation de l'Edit de Nantes, remontant à 1685 à Fontainebleau, luttaient pour leur liberté cultuelle. L'abbé avait fait capturer et emprisonner quelques jeunes gens dans sa maison, au Pont de Montvert, pour les envoyer aux galères.
C'était sans compter sur quelques réformés, dont Esprit Séguier, Abraham Mazel, Couderc et Laporte qui, au retour de la foire de Barre des Cevennes, ont décidé de délivrer les captifs. Pour ce faire ils incendièrent la maison du prêtre et conduisirent ce dernier dans l'au-delà sur le pont du village. L'ecclésiastique, probablement pour lui rappeler les soffrances du Christ, a reçu 54 coups de couteau. L'histoire ne dit pas dans quelle alvéole de cet "au-delà " fut réceptionné l'archiprêtre.
La guerre, quelques semaines plus tard, embrasa les Cévennes et dépécha sur les lieux des feudataires de la Maison de France dont les noms, pour certains, sont prestigieux.
Cette révolte des Camisards allait embraser toutes les Cévennes, avec, pour la réprimer, des chefs comme Broglie, Montrevel et Villars qui ont su symboliser, par leur immonde vassalité, l'étroitesse d'esprit d'une monarchie catholique, de "droit divin" injuste, insolente et intolérante.
Notons le rôle des partisans de Jean Cavalier, Roland, Abraham Mazel, Jouany, Castanet.... qui, courageusement, ont milité contre l'écrasement de la minorité.
Le terme de cet affrontement attendra la rencontre de Nimes, 1704, qui mit en présence Cavalier, l'humble boulanger d'Anduze*, et Villars, féal du roi. On peut, cependant, concéder qu'assiégeants et assiégés témoignaient de la même charité chrétienne transverse !
Quand Louis XIV se dĂ©cida, enfin, Ă opiner pour une politique d’apaisement il fit appel au marĂ©chal de Villars. Ce dernier offre aux camisards la libertĂ© de conscience, la dĂ©livrance des prisonniers, la fin des supplices. C'est le baron d’Aigalliers, gentilhomme protestant, qui l’aide Ă convaincre Cavalier. "L'humble boulanger" d'Anduze accepte, finalement, un brevet de colonel, 1 200 livres de pension et le commandement d’un rĂ©giment. Cette mĂ©thodologie avait fait ses preuves avec un croquant du PĂ©rigord, Pierre Grellety, qui se souleva contre la couronne en 1638.
Depuis l'aube de l'humanité il existe souvent un seuil où les présumés les plus inflexibles finissent par choir.
Les camisards attendront, néanmoins 1715, le décès de Louis XIV, pour gagner un peu plus de sérénité. C'est seulement après la grande Révolution que s'amorça, effectivement, le droit cultuel dans l'Hexagone.
(Sources diverses).
* Quand j'aborderai, vraisemblablement au cours de l'été 2004, Anduze je m'étendrai sur le personnage controversé de Jean Cavalier.
| Informations manquantes ? |
Envoyez vos textes au webmaster |
||||
| Rédacteur | ||
 |
||
05 53 29 07 50
E-Mail: pierrefabre@infonie.fr
RĂ©dacteur libre.
Diverses fiches amorcées et présentes sur le site concernent des villages meusiens disparus lors de la Première Guerre mondiale:
Beaumont-en-Verdunois, Bezonveaux, Cumières, Fleury-devant-Douaumont, Haumont-près-Samogneux, Louvemont-Côte-du-Poivre, Ornes et Vaux-devant-Damloup .
Bien d'autres localités figurent dans le listage des communes découvertes par le site. Le chantier, par essence, reste et restera toujours inachevé.
Les internautes qui découvriraient des erreurs, des imperfections ou des omissions seront, naturellement, les bienvenus s'ils me font part de leurs remarques.
Contact: pierrefabre@infonie.fr
Pierre FABRE gčre aussi les localités suivantes :
Reillanne - Drap - Gattieres - Vireux Molhain - Marseille - Arles - Aubagne - Martigues - Dives Sur Mer - Perigueux - Bergerac - Creysse - La Force - Lanquais - St Capraise De Lalinde - Belves - Carves - Cladech - Doissat - Grives - Larzac - Monplaisant - Sagelat - Salles De Belves - Siorac En Perigord - St Amand De Belves - St Germain De Belves - St Laurent La Vallée - St Pardoux Et Vielvic - St Pompon - Ste Foy De Belves - Sarlat La Caneda - Domme - Veyrines De Domme - Campagne - Journiac - Le Bugue - Mauzens Et Miremont - Cazoules - Savignac Les églises - Montferrand Du Perigord - St Avit Senieur - Bouillac - Le Buisson De Cadouin - Limeuil - Pezuls - Capdrot - Monpazier - Besse - Loubejac - Mazeyrolles - Prats Du Périgord - St Cernin De L'Herm - Villefranche Du Perigord - Salignac Eyvignes - Boulazac - Gisors - Fources - Valence Sur Baïse - Castelmoron D'Albret - Agen - Condezaygues - Cuzorn - Sauveterre La Lemance - St Front Sur Lemance - Le Pont De Montvert - St Germain De Calberte - Florac - Toul - Bar Le Duc - Cumieres Le Mort Homme - Fleury Devant Douaumont - Haumont Pres Samogneux - Louvemont Cote Du Poivre - Samogneux - Verdun - Beaumont-en-Verdunois - Bezonvaux - Ornes - Vaux Devant Damloup - Hennebont - Dives - Calais - St Omer - Capvern - Aurensan - Soues - Bazet - Strasbourg - Lyon - Venissieux - Paris - Le Treport - Veules Les Roses - Friville Escarbotin - Conteville - Ault - Entraigues Sur Sorgue - Joncherey - St Denis - Ivry Sur Seine - Vitry Sur Seine - Asnières Sur Oise
| Informations manquantes ? |
Envoyez vos textes au webmaster |
||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||